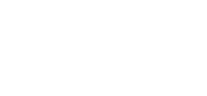Retour aux actualités précédentes
Retraite : les chiffres clés, deux ans après la réforme
Deux ans après le passage de l'âge légal de départ de 62 à 64 ans, les partenaires sociaux ont entamé des discussions visant à aménager cette réforme controversée. Retour en chiffres sur la situation.

Pour mieux appréhender le système des retraites, voici plusieurs données essentielles issues du rapport annuel 2024 du Conseil d’orientation des retraites (COR) et du rapport 2024 de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES). Ces sources fournissent les informations sur les effectifs des retraités, les montants de pension et les âges de départ à la retraite, tous régimes confondus et par régime spécifique, jusqu'à fin 2022. Aujourd’hui, les retraites représentent le premier poste de dépenses de la protection sociale avec 353 milliards d'euros versés en 2022, soit 13,4 % du PIB et 41,5 % des prestations de protection sociale.
Presque un quart de la population concernée
Fin 2022, 17 millions de personnes touchaient une pension de droit direct (c’est-à-dire, versée aux personnes qui en ont acquis les droits) de la part des régimes français, soit 175 000 de plus par rapport à 2021. Les femmes représentent 53,1 % de ces bénéficiaires contre 46,9 % d'hommes. Parmi cet ensemble, 900 000 personnes résident à l'étranger.
Par ailleurs, environ 4,4 millions de personnes touchaient également une pension de réversion, c’est-à-dire, une fraction de la retraite de leur conjoint décédé. 900 000 ne perçoivent que cette pension, sans bénéficier d’une pension de droit direct.
Des départs à la retraite de plus en plus tardifs
Aujourd'hui, l'âge moyen de départ à la retraite s'établit à 63 ans pour les femmes contre 62,3 ans pour les hommes. Cet écart s'explique principalement par les carrières plus courtes et hachées des femmes.
En 2023, cette disparité entre hommes et femmes se reflète dans les taux d'activité des 15-64 ans : 76,8 % pour les hommes contre 71,2 % pour les femmes. L'écart se creuse davantage entre 25 et 49 ans, atteignant environ 8 points.
Dénoncée par la CFE-CGC, la réforme de 2023 a repoussé l’âge légal de départ en retraite à 64 ans. Selon les projections du COR, l’âge effectif de départ devrait donc en conséquence se stabiliser à 64,4 ans pour les générations nées dans les années 1975.
Des pensions inégales entre les sexes
À décembre 2022, le montant moyen de la pension de droit direct tous régimes confondus (incluant les éventuelles majorations pour trois enfants ou plus) s'élevait à 1 626 euros mensuels bruts pour les retraités résidant en France, soit 1 512 euros nets. Ce montant connaît une légère diminution de 0,4 % par rapport à 2021. En prenant en compte la pension de réversion, le montant total atteint 1 786 euros bruts mensuels, équivalant à 1 662 euros nets.
Cependant, d'importantes disparités persistent entre les sexes puisque la pension moyenne s'élève à 2 050 euros pour les hommes retraités contre seulement 1 268 euros pour les femmes, soit une différence de 38 %. Bien que conséquente, elle tend à se réduire progressivement puisqu'elle atteignait 50 % en 2004. En intégrant les pensions de réversion (bénéficiant davantage aux femmes du fait de la mortalité plus précoce des hommes), l'écart se réduit à 26 %.
En outre, 52 % des femmes retraitées perçoivent une pension mensuelle inférieure à 1 000 euros, contre 20 % des hommes. Une inégalité qui s’explique par de multiples facteurs comme un recours plus fréquent au temps partiel et une concentration dans des métiers moins rémunérés. Selon l’Insee, en 2017, les femmes du secteur privé gagnaient en moyenne 16,8 % de moins que les hommes à temps plein.
Un niveau de vie légèrement supérieur aux actifs
Entre 2012 et 2022, la pension brute des assurés ayant touché leur retraite a diminué de 5,5 % en « euros constants » (corrigés de l'inflation). Toutefois, en intégrant les nouveaux entrants, aux pensions généralement plus élevées grâce à des carrières plus longues et des salaires en hausse, le pouvoir d’achat des retraités est resté stable (+0,8 % sur dix ans).
Ainsi, le niveau de vie médian des retraités dans un logement ordinaire (hors Ehpad ou maison de retraite) s’élève à 1970 euros par mois, soit 2,1 % de plus que l'ensemble de la population (1930 euros). De même, les retraités ne sont que 10 % à vivre sous le seuil de pauvreté, contre 14,5 % de la population générale et 20,6 % des moins de 18 ans.
La problématique du financement
Financé par les cotisations des actifs, le système des retraites affichait un excédent de 8,5 milliards d’euros en 2023. Pourtant selon le dernier rapport de la Cour des comptes, il devrait basculer en déficit dès 2025 à 6,6 milliards d’euros, puis à 15 milliards d’euros en 2035 et à 30 milliards d’euros en 2045, en prenant une hypothèse de productivité de 0,7 %.
Cette hausse des déficits s’explique par un déséquilibre démographique croissant : le nombre de cotisants diminue tandis que les retraités vivent plus longtemps et perçoivent des pensions plus élevées. En effet, si la France comptait 4,1 actifs par retraité en 1960, contre 3 en 1970, et 1,7 aujourd’hui. Ce ratio pourrait passer à 1,4 d’ici 2070. De surcroît, la durée de vie moyenne en retraite est passée de 15 ans en 1965 à plus de 24 ans en 2023.
Un « conclave » sur les retraites
Mi-janvier, le gouvernement a donc mandaté les organisations syndicales et patronales représentatives au sein d’un « conclave », auquel participe la CFE-CGC. Objectif, amender la réforme des retraites de 2023 et proposer un rééquilibrage du système financier à l’horizon 2030.
François Tassain