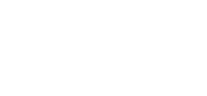Sortie de crise, aides aux entreprises, dette publique, salaires… Président de l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), Xavier Ragot dresse un état des lieux de l’économie française.
Dix-huit mois après le début de la crise sanitaire, comment se porte l’économie française ?
Sous réserve d’un nouveau choc sanitaire, nous sommes clairement dans une trajectoire de sortie de crise. La gestion de la crise Covid a été très différente de la crise financière de 2008, marquée par de fortes politiques d’austérité les années suivantes. Cette fois, l’Europe et la France ont utilisé beaucoup plus de marges de manœuvre budgétaires. L’État a choisi d’augmenter sa dette publique en soutenant massivement les revenus des ménages et les entreprises, par le biais de dispositifs - activité partielle, fonds de solidarité et prêts garantis par l’État (PGE) - dont le montant se chiffre à 230 milliards d’euros environ. Globalement, malgré certains trous dans la solidarité nationale, en particulier concernant les jeunes, les revenus des ménages sont restés stables, avec un surcroît d’épargne d’environ 160 milliards d’euros, car la consommation a chuté. Avec la sortie de crise amorcée, la consommation repart. Les entreprises se sont beaucoup endettées mais ont, en moyenne, conservé de bons niveaux de trésorerie malgré de fortes disparités selon les secteurs. Autres points positifs : la vague de faillite a été moindre qu’escomptée et l’investissement se porte plutôt bien.
Dans le même temps, on a changé de monde puisque la dette est passée de 100 % à plus de 116 % du PIB et que le déficit 2021 devrait atteindre 9 %. Pour résumer, en matière de gestion de crise, on peut dire que Keynes a gagné, avec un soutien massif à l’économie. Le rétablissement des comptes publics est certes un débat important, mais il doit être progressif.
Quel bilan faites-vous des mesures de soutien aux entreprises ?
Cette politique d’aides massives du « quoi qu’il en coûte » a été globalement positive malgré certains effets secondaires dont quelques effets d’aubaine et ce que j’appelle la mauvaise allocation du capital, c’est-à-dire allouer de l’argent public à des entreprises structurellement inefficaces qui auraient normalement dû contracter leur activité ou faire faillite.
Le gouvernement veut désormais limiter l'aide de l'État aux entreprises et aux secteurs les plus sinistrés. Quelle approche préconisez-vous ?
L’exécutif souhaite dorénavant « faire de la dentelle », c’est-à-dire remplacer des soutiens massifs par des aides par entreprise. Or pour cela, il faut des dentelières et l’État n’a pas forcément tous les outils pour agir aussi finement. La dimension sectorielle est fondamentale et doit être appréhendée sous toutes ses interdépendances. Il s’agit de sortir progressivement des mécanismes de soutien, en faisant un bilan précis de la situation des entreprises et des faillites. Il convient aussi d’actionner les mécanismes de renégociation de dettes avec les tribunaux de commerce.
Quel regard portez-vous sur le plan de relance de 100 milliards d’euros mis en place l’an dernier ?
À l’origine, c’est à la fois un plan de soutien, de relance économique et d’investissements. Désormais, nous devons nous projeter sur l’évolution du tissu productif à cinq et dix ans et sur l’après-crise. Alors que les taux d’intérêt sont historiquement très bas, le coût du remboursement de la dette n’a jamais été aussi faible avec des intérêts à payer de l’ordre de 1 à 1,2 % du PIB, contre 3 % au début des années 2000, quand la dette était à 60 % du PIB, contre 116 % aujourd’hui. C’est un puissant paradoxe : la dette publique est élevée mais son coût est historiquement faible. Le contexte est donc propice pour mener des investissements d’infrastructures bien ciblés de long terme, avec un État entrepreneur. J’insiste : investissons maintenant pour créer la croissance de demain dans des domaines clés : transition énergétique, numérique, politique industrielle, recherche fondamentale, recherche pharmaceutique, formation professionnelle et enseignement supérieur.
La problématique de la dette suscite beaucoup de débats. Quelle est votre position ?
C’est un sujet sérieux qui ne doit pas être caricaturé par les tenants de l’annulation de la dette ou ceux qui affirment que le pays est en faillite. Oui, le niveau de la dette publique mondiale est aujourd’hui à un niveau jamais connu dans le capitalisme. Mais dans le même temps, jamais les taux d’intérêt n’ont été aussi bas, résultant d’une épargne très importante, supérieure aux investissements, et de la concurrence que se livrent les acheteurs de dette publique que sont les banques centrales, les ménages et les entreprises. Cela crée un schéma inédit, dit de stagnation séculaire, composé d’États endettés et de sous-investissements. C’est un nouveau monde. Il faut lutter contre l’idée selon laquelle l’État serait en faillite : c’est faux. Des efforts seront à faire mais on peut vivre avec des taux d’endettements publics élevés à long terme. Il faut rappeler que les taux d’intérêt décroissent de manière continue depuis 40 ans et que s’ils remontaient, nous aurions les moyens d’ajuster les choses pour assurer la soutenabilité des dépenses publiques.
Les entreprises font état de fortes difficultés pour recruter. Qu’en est-il ?
D’une part, près d’un million de salariés sont encore en activité partielle. Par ailleurs, les difficultés de recrutement étaient déjà importantes en 2019, où les embauches étaient aussi très élevées. On a donc l’impression d’une économie qui réapprend à embaucher et former. Il faut cependant une amélioration des qualifications et de la formation continue des salariés. Les entreprises doivent y prendre toute leur part. Dans certains secteurs comme les services à la personne ou la construction, il y a un problème d’attractivité des métiers. Si les entreprises ont du mal à recruter, c’est aussi à elles de se rendre attractives.
Dans ce contexte, le Medef s'attend à des augmentations de salaires « significatives » en 2022. Est-ce réaliste ?
Après cette crise, les salariés ont réestimé la pénibilité de certains métiers. Cela va conduire à des demandes d’amélioration des conditions de travail, par des hausses de salaires mais aussi par des contrats plus longs ou des CDI à la place de CDD, et par une réorganisation du travail. J’anticipe cependant un débat sur les hausses de salaires en France moins vif qu’aux États-Unis, en Allemagne ou en Espagne, où les salaires ont globalement diminué dans la valeur ajoutée.
Ensuite, on assiste à un retour timoré de l’inflation, cependant bien plus faible en France qu’aux États-Unis. Cela va relancer le débat sur les hausses de salaires et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise. Il faut voir d’un bon œil une inflation proche de 2 % : cela donne du « grain à moudre » pour le dialogue dans les entreprises. Pour ma part, je suis plutôt inquiet que l’inflation reste sous les 2 % après l’ajustement des prix des matières premières et agricoles, dont la hausse est très conjoncturelle.
La thématique d’un meilleur partage de la valeur revient dans le débat public. Quelle est votre analyse ?
Nous faisons en partie face à des trappes à bas salaires, créées par la défiscalisation des emplois peu qualifiés au voisinage du SMIC, au détriment de véritables trajectoires de dynamique salariale. Il convient, par le biais du dialogue social, d’améliorer la répartition des richesses créées dans l’entreprise et la représentation des salariés dans les conseils d’administration pour responsabiliser toutes les parties prenantes.
Propos recueillis par Mathieu Bahuet