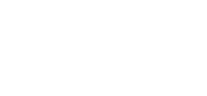FRANÇOIS HOMMERIL : « ÉLEVER LE NIVEAU DES DÉBATS ET FAIRE AVANCER LA SOCIÉTÉ »
En préambule, François Hommeril, président confédéral, a insisté sur la volonté constante de la CFE-CGC « d’élever le niveau des débats, d’y être compétitifs pour peser, porter des idées et faire avancer la société sur tout un nombre de sujets ». S’agissant des services publics, il invite notamment tout un chacun à « sortir du sempiternel débat sur les équilibres des comptes et le quantitatif qui phagocytent le débat public », et à s’intéresser « au qualitatif, à l’organisation du travail et aux gens qui travaillent au sein de ces services publics, dans toute leur typologie ».
HISTORIQUE DES SERVICES PUBLICS EN FRANCE ET INFLUENCE EUROPÉENNE
Dans la première table ronde consacrée à l’histoire des services publics, Claire Lemercier, directrice de recherche au CNRS, coautrice de divers ouvrages (« La valeur du service public », « La Haine des fonctionnaires »…), a retracé l’historique en France depuis le 19e siècle avec « différentes étapes de définitions juridiques du service public, sans forcément stipuler que ceux-ci sont organisés ou gérés par l’État, mais indiquant qu’ils concernent potentiellement toute la population avec l’idée qu’ils correspondent à un besoin d’intérêt général ».
L’historienne a rappelé que les premiers services publics ayant occasionné d’importantes dépenses concernaient les infrastructures (La Poste, le télégraphe, les chemins de fer…) d’abord destinées aux entreprises. Sur la situation actuelle et face au discours selon lequel « le privé ferait mieux avec un grand M », elle estime fondamental « d’interroger ce qu’on demande de faire à tel service public et comment, et de répondre à ces trois questions - qui paye, qui fait, qui décide - avant d’établir diverses articulations publiques-privées ».
Mélanie Vay, docteure en science politique (CESSP, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) et responsable d'études et de recherches à l'Institut Robert Badinter, a ensuite apporté un éclairage historique européen, rappelant en particulier que le concept de service d'intérêt économique général (SIEG) trouve sa source dans le traité de Rome de 1957 et que ces SIEG, en leur qualité de régimes particuliers, peuvent, dans une certaine mesure, être exonérés des règles de la concurrence. La chercheuse a expliqué que, « progressivement, la jurisprudence européenne a contribué à une conception relativement restrictive des services d'intérêt économique général ». Par exemple quand l’Europe a contesté la possibilité aux entreprises publiques de faire de la péréquation (mécanisme de comblement des déficits d'exploitation d'une activité par les excédents d'exploitation d'autres activités).
COMPÉTITIVITÉ ET EFFICIENCE DES SERVICES PUBLICS
Dans la deuxième table ronde centrée sur la dimension économique des services publics, Benjamin Brice, docteur en sciences politiques, auteur de plusieurs ouvrages (« L’impasse de la compétitivité », « La Sobriété gagnante »), a exposé combien la compétitivité a été érigée en seul dogme de toutes les réformes économiques et sociales conduites depuis une quinzaine d’années. « Dans le contexte actuel de crise politique, économique et sociale du pays, il y a aujourd’hui consensus autour du constat d’une dégradation de nos services publics, juge-t-il. Si la compétitivité est une nécessité dans une économie ouverte, elle est devenue une obsession dans le débat public. Aujourd’hui, le déficit public n’est pas la priorité. La priorité, c’est l’investissement dans l’industrie, dans l’éducation, dans la transition écologique. »
Dans un contexte budgétaire contraint, comment préserver l’efficience de nos services publics ? Expert associé à l’OFCE en économie et politiques publiques et président du Cabinet UNO Études & Conseil, Bruno Coquet a dressé un état des lieux de la situation. « Alors que la musique budgétaire est actuellement très forte dans le pays, il me semble que la question fondamentale à se poser est la suivante : le service public est-il rendu ? Si la France a longtemps eu la réputation d’avoir des services publics efficients, je pense aujourd’hui qu’à bien des égards, le service public n’est plus rendu et que l’organisation est globalement inefficiente. On le mesure dans l’éducation, dans la santé, dans la sécurité, ou encore avec l’apparition de médiateurs pour les services publics. »
Dès lors, comment améliorer les choses ? « Les choix doivent être éclairés par la comptabilité, insiste Bruno Coquet. Quand on observe l’administration dans son ensemble, il y a, par rapport au secteur privé, un déficit de comptabilité, de données budgétaires, de chiffres et d’harmonisation des bilans. C’est un vrai sujet. S’il y a un problème financier dans le service public, il s’agit en premier lieu de le qualifier. Ce d’autant que, dans l’esprit de nos concitoyens, perdure cette idée selon laquelle le service public serait gratuit. Or il est difficile de se réguler collectivement quand le prix n’apparait pas. »
Benjamin Brice a par ailleurs rappelé que ce qui a augmenté au fil du temps dans les dépenses publiques, ce sont les transferts vers les ménages et les entreprises. « Si on prend les dépenses de fonctionnement dans la comptabilité nationale, c’est-à-dire toute la rémunération des agents publics et ce dont ils ont besoin pour travailler (la consommation intermédiaire), on s’aperçoit que la part de PIB - environ 18 % - est remarquablement stable depuis quasiment un demi-siècle. Et ce alors même que la pression devient plus forte sur les services publics, par exemple sur l’hôpital public en raison du vieillissement de la population. »
Il a aussi cité les salaires des enseignants, « qui ont complètement décroché depuis 40 ans », occasionnant « une dégradation problématique du statut de la profession dans notre société ». Un constat partagé par Bruno Coquet qui pointe « une paupérisation globale de la fonction publique, avec notamment une problématique de rémunération des agents ».
TRANSFORMATION DES ENTREPRISES PUBLIQUES ET ADAPTATION DE L’ÉTAT ACTIONNAIRE
Lors de la troisième table ronde dédiée à la façon dont l’État se comporte vis-à-vis de ses propres entreprises publiques et quant à savoir s’il est devenu un actionnaire comme un autre, Hadrien Coutant, maître de conférences en sociologie à l’Université de technologie de Compiègne et chercheur au sein du laboratoire Costech, a fait part de ses travaux sur les entreprises à capitaux publics.
« Ces dernières décennies, l’État a de plus en plus cherché à se comporter comme un actionnaire, en suivant les indicateurs financiers des entreprises publiques et en les contrôlant via le conseil d’administration (CA). De leur côté, ces entreprises publiques ont connu des transformations assez profondes avec un processus dit de normalisation dans leur fonctionnement, en intégrant les notions marchandes et de compétitivité comme n’importe quelle entreprise. Cela a occasionné une remise en cause des statuts spécifiques des agents, le développement des établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC), un abandon des logiques de filières et, plus largement, une financiarisation accrue des entreprises à capitaux publics. Cette financiarisation est d’ailleurs souvent impulsée par les représentants de l’État dans les CA, avec une vision court-termiste et une exigence accrue en termes de versements de dividendes. »
Interrogé sur l’efficacité des services publics, Hadrien Coutant en appelle à déconstruire certains discours, soulignant que « tout dépend ce qu’on leur demande de faire » et rappelant qu’une bonne partie des entreprises à capitaux publics sont rentables. « Quand l’État gouverne les entreprises publiques comme des entreprises normales, c’est aussi une façon d’abandonner les objectifs de politique publique et l’utilité de politique publique qu’on leur assigne, observe-t-il. Cela devient dès lors assez nébuleux. »
Autre point saillant de son intervention : le fait que l’État actionnaire, dans ce processus de recherche de compétitivité des entreprises publiques et cette volonté d’en faire des champions internationaux, a parfois eu tendance à se désintéresser des conséquences, par exemple la fermeture de sites en France. Enfin, élargissant le débat au-delà du cas français, Hadrien Coutant a mis en avant que « le capitalisme d’État, à l’échelle mondiale, est aujourd’hui en phase de croissance, en particulier sous l’impulsion de la Chine et des pays émergents ».
UN SECOND COLLOQUE SERVICES PUBLICS LE 3 FÉVRIER 2026
Après une série de questions-réponses avec la salle et les internautes, André Thomas a remercié tous les participants et conclu le colloque : « Tous ceux qui pensent, tous ceux qui cherchent, tous ceux qui réfléchissent aident la démocratie, le syndicalisme et le progrès humain à se sentir vivants. Et ce soir, grâce aux différents intervenants, nous nous sommes sentis bien vivants ! » Rendez-vous désormais le 3 février 2026 pour le prochain colloque CFE-CGC sur les services publics.
Mathieu Bahuet