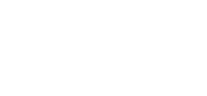Comment se portent les PME en France ?
En France, les PME sont majoritairement des TPE puisqu’au-delà de 50 salariés, beaucoup d’entreprises sont des filiales. Leur petite taille initiale fait que nombre d’entre elles ont des difficultés à se développer et à atteindre leur échelle minimale d’efficience. Elles sont de ce fait en situation de faiblesse sur leur marché et présentent donc un taux de défaillance élevé, beaucoup se faisant racheter par d’autres entreprises. Cela dit, certaines réussissent très bien, le tout étant de leur laisser le temps.
Pourquoi l’importance de ce facteur temps ?
Régulièrement revient la mode des « gazelles », ces entreprises qui ont des taux de croissance du chiffre d’affaires et de l’emploi plus élevés que la moyenne. Une théorie datant du milieu des années 1980 - et qui est fausse - avance que ce sont elles qui créent l’essentiel de l’emploi dans l’économie. Donc, de temps en temps, alors que beaucoup d’évidences empiriques vont à l’encontre de cette idée, les pouvoirs publics s’engagent dans des politiques de soutien aux gazelles. Ce n’est pas forcément un bon choix car ces entreprises à forte croissance grandissent vite mais pas longtemps. Ensuite, comme si cette croissance rapide les épuisait, elles deviennent fragiles. Pour consolider une entreprise, il faut de la patience.
Une grande partie des création d’emplois n’est-elle pas toutefois à porter au crédit des PME et des TPE ?
Certainement. À ce sujet, il convient de rappeler que les grands groupes ont la particularité de beaucoup embaucher quand la conjoncture est bonne, mais aussi de beaucoup licencier en période de crise. Les PME, au contraire, jouent un rôle d’amortisseurcar elles surfent moins sur la vague économique. Leur comportement est plus régulier : elles recrutent à un rythme moins élevé mais « décrutent » aussi moins vite, notamment parce que leur gestion des ressources humaines est marquée par une proximité de tout type entre les employeurs et les employés. Dans une PME, un salarié occupe souvent plusieurs fonctions, ce qui rend difficile de se priver de sa compétence. Les PME sont donc moins volatiles que les grandes entreprises dans leurs comportements d’embauche et de licenciement.
Les PME françaises sont-elles sous-capitalisées ?
On a longtemps cru cela, notamment par comparaison avec l’Allemagne, en oubliant que les entreprises allemandes doivent provisionner pour les retraites alors que les françaises n’y sont pas tenues. Ce biais de comparaison a été gommé par la Centrale européenne des bilans qui traite les bilans des entreprises de manière à les rendre comparables. Elle a permis de constater que les écarts étaient beaucoup moins défavorables aux entreprises françaises qu’ils ne semblaient a priori. La relative faiblesse de leur haut de bilan s’explique aussi par un accès au crédit qui a longtemps été assez facile.
Et aujourd’hui, qu’en est-il ?
La crise liée à la pandémie de Covid-19 a bouleversé la situation. Les premières mesures d’urgence mises en place au printemps dernier - notamment le prêt garanti par l’État (PGE) - et la baisse de l’activité et de l’investissement sont à l’origine d’une déformation de la structure financière des entreprises. Faute de pouvoir investir et tournant au ralenti, elles détiennent aujourd’hui des réserves colossales qui sont reflétées par les données sur les dépôts publiées par la Banque de France.
Les PME françaises ont donc tant de réserves ?
Aussi étonnant que cela puisse paraître, les entreprises connaissent aujourd’hui une situation de trésorerie exceptionnelle. Ce qui n’empêche pas qu’elles éprouvent des difficultés car les chiffres d’affaires connaissent une forte baisse. La question qui se pose est de savoir comment elles vont sortir de cette situation. Parviendront-elles à honorer leurs dettes ? Vont-elles s’engager dans des projets d’investissements compte tenu de l’incertitude qui prévaut ? Le principal problème actuellement est de trouver des entreprises qui investissent. Pour cela, elles doivent pouvoir anticiper une demande qui, en l’état, risque de rester durablement faible. Le plan de relance est principalement axé sur la compétitivité et l’offre mais rien ne garantit que cette recette fonctionne.
Le coût du travail trop élevé en France est-il une autre idée reçue ?
Quand on regarde globalement la différence de salaires, ils sont en effet plus élevés en France que dans d’autres pays d’Europe. Mais si l’on sort deux secteurs de la comparaison, la finance et les assurances, le coût du travail en France devient alors légèrement inférieur à celui de l’Allemagne. Ce qui coûte cher en France, c’est le travail dans les services, en particulier les services « supérieurs » comme la finance, la gestion de portefeuille, les services juridiques et comptables, etc.
L’autre différence réside dans le fait que les entreprises françaises sont spécialisées dans des marchés où la concurrence s’opère par les prix. L’industrie allemande s’est plutôt orientée sur des marchés où la concurrence passe par la qualité et la différenciation des produits. Les entreprises engagées dans cette voie peuvent vendre plus cher, si bien que la part du coût du travail dans le prix de vente final est moins important. Cette situation est le résultat de choix stratégiques qui ont été en partie entretenus par les exonérations de cotisations sociales massives dont bénéficient depuis 1993 les entreprises françaises. Ces dispositifs les ont amenées à privilégier des investissements substituant du travail rémunéré autour du SMIC à du travail qualifié et au capital productif innovant. Nombre d’entreprises ont ainsi fini par se spécialiser dans ce que l’OCDE appelle les moyenne et basse technologies, ce qui les expose à une concurrence sur les prix. Du point de vue de l’entreprise, comme de l’ensemble de l’économie, cette orientation a été une grave erreur.
Les allègements de cotisations sociales patronales sont donc une fausse bonne idée économique selon vous ?
Complètement ! D’abord parce que ce sont des trappes à bas salaires, ensuite parce que cela incite les entreprises à se spécialiser dans des productions qui reposent sur la minimisation du coût du travail. Étant sans cesse soumises au risque lié à l’arrivée de concurrents produisant moins cher, elles ne sont plus maitresses de leurs prix de vente et doivent s’engager toujours plus dans des stratégies de réduction des coûts.
Sur quoi portent vos recherches actuellement ?
Je cherche à savoir pourquoi certains territoires accueillent plus d’entreprises en croissance que d’autres, comment l’entreprise transforme le territoire et comment celui-ci l’influence. Par territoire on entend le milieu économique global dans lequel évoluent les acteurs. Il incorpore les circuits de financement, la fiscalité locale, les entreprises implantées, les politiques publiques de soutien à l’économie, les choix de spécialisation, etc.
Quels en sont les premiers résultats ?
Contrairement à une thèse très partagée, toutes les métropoles ne sont pas forcément très dynamiques ni créatrices d’emploi. Nous avons comparé la croissance des emplois de chaque métropole par rapport à celle des zones qui leur sont contiguës. Cette méthode a permis d’isoler des métropoles « rayonnantes » qui correspondent au cas idéal où la grande ville ruisselle sur ses territoires alentours, comme Rennes par exemple. D’autres sont au contraire quant à elles « autocentrées » comme Toulouse, qui croît beaucoup plus vite que sa périphérie. Un autre cas de figure correspond aux métropoles à « dynamique inversée » au sens où la périphérie est plus dynamique que le centre, à l’image de Strasbourg. Enfin, il existe des cas où la métropole et sa périphérie se portent également mal comme à Nancy ou Metz.
Soumettez-vous ces résultats aux métropoles ?
Les travaux ont été menés en partenariat avec l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), France Stratégie et la Caisse des dépôts. Des restitutions ont été organisés pour présenter les résultats à des acteurs de la sphère économique et des décideurs locaux. Tous sont libres de s’en saisir ou de chercher à les approfondir. Nous travaillons actuellement sur le cas de Lille, de ses relations avec le bassin minier, de sa position dans les Hauts-de-France et par rapport à la Belgique.
Propos recueillis par Gilles Lockhart