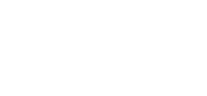Retour aux actualités précédentes
« Acculturer les militants syndicaux sur l’intelligence artificielle »
Économiste à l’IRES et coordinatrice du projet Dial-IA piloté par 4 organisations syndicales dont la CFE-CGC pour outiller les acteurs du dialogue social aux enjeux de l’IA au travail, Odile Chagny livre ses analyses pour une mise en œuvre vertueuse.

Au sein de l'Institut de recherches économiques et sociales (IRES), vous êtes économiste et animatrice du réseau Sharers & Workers. En quoi consistent vos travaux ?
Mon parcours a toujours été centré sur des activités marquées par une démarche prospective telles que des projections économiques afin d'anticiper les transformations des modes de production, l'évolution du travail et les mécanismes de régulation. Puis j’ai recentré mes activités au service du monde syndical. Depuis mon arrivée à l’IRES, je mène des projets de recherche action collaboratifs visant à aider les acteurs à réfléchir, dans une démarche prospective, sur l'impact des transformations numériques sur le monde du travail et le dialogue social. Le réseau « Sharers and Workers », lancé en 2016 par l’IRES en partenariat avec l’ASTREES (Association travail emploi Europe société), s'est inscrit dans une démarche d'expérimentation collective sur ces enjeux.
En début d’année, l’IRES et 4 organisations syndicales (CFE-CGC, CFDT, FO-Cadres, Ugict-CGT) ont présenté le projet Dial-IA (dialoguer sur l’IA ) pour sensibiliser les acteurs du dialogue social aux enjeux de l’intelligence artificielle au travail. Quelle en est la genèse ?
Après deux ans de travail, nous avons prolongé notre réflexion, cette fois avec une approche intersyndicale et en se concentrant sur le contexte français. L'opportunité s'est présentée en 2022 quand l'ANACT (Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail) a lancé un appel à projets sur le numérique et le dialogue social technologique, qui s'appuyait sur l'accord-cadre européen de juin 2020 sur la transformation numérique des entreprises. L'IRES a déposé une candidature, dans la logique de prolongation du projet SeCoIA Deal, mais avec cette dimension intersyndicale. C'est ainsi que s'est créé ce projet rassemblant la CFE-CGC, la CFDT, FO Cadres et l’Ugict-CGT. Nous avons aussi pu compter sur la participation de Solidaires Finances Publiques, de la CFTC Médias+, de représentants de l'organisation patronale UNAPL et du secteur numérique.
Les représentants du personnel doivent avoir la capacité de comprendre un projet d'IA, ses étapes, ses spécificités »
Quels outils ou leviers opérationnels sont mis à disposition des représentants du personnel pour accompagner le déploiement de ce dialogue social technologique ?
Nous avons développé divers outils, co-produits par un collectif de 20 parties prenantes parmi les 50 qui ont participé au projet Dial-IA. J’insiste sur cette dimension collaborative ! Une première partie de notre travail vise à apporter des ressources pour s'acculturer à l'IA. Si les militants syndicaux n'ont pas vocation à devenir experts de l'IA, ils doivent avoir la capacité de comprendre un projet d'IA, ses étapes, ses spécificités. Le premier outil mis à leur disposition est un ensemble de ressources d'acculturation disponibles sur le site internet dial-ia.fr pour comprendre les étapes d'un projet de déploiement d'IA : cahier des charges, développement, tests, apports internes et externes à l'entreprise. Si on ne comprend pas comment fonctionne un projet d'IA, on n'est pas capable d'accompagner son déploiement pour qu'il soit vertueux. Comprendre les projets d’IA est une condition sine qua non de la discutabilité de ces systèmes : il faut se confronter aux situations vécues.
Le deuxième volet concerne le dialogue social : de la conception à la maintenance des systèmes d'IA, nous expliquons comment organiser un dialogue social interactif qui s'appuye sur le Code du travail mais aussi sur des outils innovants comme le registre des systèmes d'IA, un outil développé dans le cadre du projet SeCoIA Deal pour permettre une mise en visibilité de l'IA, de ses finalités, de son coût, etc. Ces deux dimensions - comprendre et s'acculturer à l'IA ; disposer d'outils et leviers opérationnels pour mettre en place un dialogue social à toutes les étapes d'un projet - se traduisent par des fiches téléchargeables dont un « kit de survie du dialogue social ».
Comment les salariés et leurs représentants perçoivent-ils l’IA ?
Leur opinion et leur vision évoluent beaucoup. La logique de très nombreux projets est top down : elle est imposée par les directions. Mais les cas d’usages augmentent rapidement, en particulier avec les pratiques de « shadow IA ». Aujourd’hui, les salariés s’interrogent sur les impacts que l’IA peut avoir sur leur travail. Certains craignent d’être remplacés mais d’autres s’intéressent à ce que l’IA peut leur apporter dans l’exercice de leur métier. Il y a une réelle prise de conscience et il est donc indispensable de mettre en place des dispositifs de dialogue social afin que les salariés soient informés et consultés par les directions d’entreprises.
Quels sont les risques sociaux liés à une utilisation non encadrée de l’IA dans les entreprises ?
Les conséquences de l'IA sont plurielles mais elles impactent d'abord le travail avant d'affecter l'emploi lui-même. Prenons le management algorithmique par IA. Ce dernier implique une forme de management immédiat, souvent opaque, où le contrôle humain est réduit et remplacé par des interactions homme-machine. C’est totalement inédit. Cela soulève de nombreuses questions et inquiétudes car on risque de se retrouver avec une surveillance accrue, une perte d’autonomie des salariés et une baisse des interactions humaines. Un autre risque est le manque de transparence et d'explicabilité des informations que fournit un système d'IA. Si le « manageur IA » n’apporte pas d’explications ou de justifications satisfaisantes sur l’accord ou le refus d’une augmentation salariale par exemple, l’expérience ne fonctionnera pas. Tous ces aspects n’impactent pas directement l’emploi des salariés mais influencent considérablement leur travail et son organisation.
L'enjeu premier réside dans la façon dont les systèmes d’IA sont introduits en entreprise »
De nombreuses études évoquent d'importants gains de productivité et de temps mais aussi de facilitation des tâches lorsque l’IA prend en charge celles qui sont chronophages et à faible valeur ajoutée. Mais ces gains entraînent souvent la suppression de postes. À l’international, des travaux menés notamment par le FMI montrent une très grande incertitude sur les impacts réels des systèmes d'IA une fois déployés. Car ces derniers ne peuvent être proprement mesurés qu’à la suite de leur réalisation, et après un certain temps. Pour l’instant, nous avançons donc pour beaucoup à l’aveugle. Ces préoccupations sont amplifiées par la manière dont les projets d'IA sont mis en place : ces technologies dont les effets sont incertains sont souvent introduites avant d’être matures, dans des modes de projets agiles. D'après le BIT, cette méconnaissance des conséquences futures constitue la principal inquiétude. L'enjeu premier réside donc dans la façon dont ces systèmes d’IA sont introduits en entreprise.
Comment convient-il de procéder ?
À nos yeux, le meilleur moyen de réduire l'impact potentiellement négatif de ces systèmes est de procéder à une mise en discussion collective, en associant les dirigeants avec les élus du personnel. Ces derniers sont essentiels pour mesurer l'impact que le système d’IA va avoir sur l'organisation et le travail. Il est impensable d’attendre la fin du déploiement d’un système IA pour en évaluer les conséquences. Notre conviction, c'est que la condition de réussite de ce type de projet réside dans son accompagnement par une démarche de dialogue social interactif, du début à la fin. Un observatoire canadien a démontré que plus nous associons les parties prenantes au projet, meilleurs sont les résultats, tant pour le personnel que pour la productivité et l'efficacité globale du projet.
Le droit du travail est-il suffisamment outillé pour encadrer l’usage de l’IA ou faut-il faire évoluer le cadre juridique ?
Nous disposons d’outils déjà utilisés comme le règlement général de protection des données (RGPD) et le règlement européen sur l'IA en cours de déploiement. Mais les outils dont nous disposons dans le Code du travail sont principalement conçus dans une logique statique. Ils interviennent lors de l'introduction d'une nouvelle technologie, de manière figée. Si nous tenons compte de la dimension temporelle d'un projet d'IA, de son cycle de vie, du fait que les recommandations peuvent évoluer au cours du temps du fait de l’adaptabilité du système, nous avons besoin d'un dialogue social à toutes les étapes du projet. En incluant les représentants du personnel dans les discussions stratégiques et avec la nécessité d’un accord avec CSE. Le processus classique d'information-consultation ne permet que difficilement ce dialogue social itératif nécessaire pendant l’introduction de nouvelles technologies et de projets IA.
Hélas, peu d'entreprises ont le réflexe d'introduire ce genre de démarche, d'où la nécessité de réfléchir à des accords de méthode qui permettent de les organiser. Mais ce n’est sans doute pas suffisant. Il faudrait penser à d'autres outils, par exemple le registre des systèmes d’IA précité. Il est aussi possible d’instaurer des comités de suivi et d'éthique pour organiser le dialogue social afin de s’assurer de son efficacité tout au long du projet. Cette logique de dialogue social dès l’amont a été confortée par la jurisprudence suite à une décision du tribunal judiciaire de Nanterre en février dernier qui a ordonné la suspension du déploiement de plusieurs outils d'IA en phase pilote dans une entreprise pour défaut de consultation préalable des représentants du personnel.
La part des gains de productivité permise par l’IA doit garantir un partage équitable »
Le manifeste commun de l’IRES et des organisations syndicales insiste notamment sur la nécessité de construire le partage de la valeur créé dans les entreprises qui recourent à l’IA.
La création de valeur permise par l’IA est potentiellement de grande ampleur mais elle doit prendre en compte l’impact des changements induits par l’IA sur le travail. C’est d’abord au travers de la transformation des activités que cette valeur se crée. La part des gains de productivité permise par l’IA doit donc garantir un partage équitable de ces avantages entre travail et capital. Or il n’est pas facile de mesurer les innovations et la valeur créée rendues possibles par l’IA dans une filière. Dans l’expertise automobile par exemple, l’IA modifie la création de valeur entre les assureurs, les experts et les réparateurs : les frontières sont brouillées. Par ailleurs, en introduisant des systèmes d’IA dans l’entreprise, des salariés et des manageurs sont amenés à les entraîner et les développer. Que fait-on de cette valeur créée ? Comment la mesurer ? Pour l’heure, ce sont surtout les fournisseurs d’IA et ceux qui collectent et valorisent les données qui en tirent le bénéfice économique. Il s’agit donc de construire le partage de la valeur créée dans les entreprises qui recourent à l’IA voire, plus généralement, dans l’écosystème qui crée la valeur.
J’ajoute que, comme toute autre technologie, l’IA ne peut pas avoir comme seule finalité la rationalisation économique, la productivité ou la réduction des coûts. Il faut s’assurer de règles loyales d’affaire et garantir qu’elle contribue à produire des solutions au service de l’intérêt général, respectueuses de la protection des données et des droits fondamentaux.
Y a-t-il aujourd’hui un réel dialogue social sur l’IA dans les entreprises ? Avez-vous des exemples ?
Si environ seulement 1 % des accords d’entreprises recensées par Légifrance (ndlr : le service public de la diffusion du droit) portent ou font référence à l’IA, et qu’il faut bien reconnaître qu’il y a encore peu de cas d’usages vertueux, plusieurs études, dont celle du Centre d'études de l'emploi et du travail (CEET), montrent que les choses bougent et que le sujet prend de l’ampleur. Il y a une prise de conscience manifeste des représentants du personnel pour s’acculturer, monter en compétences sur toutes ces problématiques et les porter à l’agenda du dialogue social dans les entreprises et les administrations. Mais tout cela prend du temps, d’autant que les directions ne sont pas toujours allantes sur le sujet ! On peut probablement s’attendre à du contentieux face à des cas avérés de délits d’entrave.
En termes de secteurs d’activité, on peut citer des concertations dans les assurances, la banque, l’énergie, l’industrie aérospatiale, etc. Je pense notamment à celle très innovante menée chez AXA, fin 2024, avec une véritable démarche itérative de dialogue social : expérimentation, information-consultation des représentants du personnel, mise en place d’un comité de suivi, anticipation des usages de l’IA sur les emplois et les compétences…
Ces sujets s’inscrivent dans l’actualité avec l’entrée en vigueur progressive, depuis juin 2024, du règlement européen sur l’IA (AI Act). Que faut-il en attendre ?
Ce règlement n’a pas été conçu pour le monde du travail. C’est un règlement libéral. Sa base légale est l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’UE. Son objectif principal est de stimuler l’adoption et la diffusion de l’IA dans l’UE en établissant un cadre juridique uniforme « pour une IA digne de confiance ». Il n’a pas vocation, comme le RGPD d’ailleurs, à traiter spécifiquement les enjeux relatifs au travail. Cela étant, ce règlement européen va impacter la façon dont les systèmes d’IA vont se déployer dans les environnements de travail. Il établit des droits - certes limités - dont il faut s’emparer. L’article 26 stipule ainsi qu’avant l’introduction et l’utilisation d’un système d'IA à haut risque, les représentants des salariés doivent être informés. On peut aussi citer des dispositions en termes de droits à la formation aux systèmes d’IA et au contrôle humain visant à prévenir ou réduire les risques pour la santé, la sécurité ou les droits fondamentaux. Les élus du personnel auront un rôle majeur à jouer comme « contrôleurs de premier niveau » dans l’introduction des systèmes d’IA.
Comment imaginez-vous le rôle des syndicats face à l’essor de l’IA ?
Les syndicats et leurs militants sont au cœur de la dimension organisationnelle du travail dans les entreprises et les administrations. Ils ont cette vision à 360 des impacts sur les collectifs de travail et les orientations stratégiques. Ce sont des acteurs de premier plan pour y développer le dialogue social technologique avec les directions. Ce qui nous ramène à l’enjeu fondamental de formation et d’acculturation des militants syndicaux. Il conviendrait d’ailleurs selon moi de développer les modules conjoints de formation entre élus du personnel et services RH des entreprises.
Seriez-vous favorable à une négociation nationale interprofessionnelle entre partenaires sociaux sur les usages de l’IA en entreprise ?
Absolument, même si je ne suis pas décisionnaire en la matière ! Le projet Dial-IA contribue à sa façon à poser les bases d’un possible futur accord national interprofessionnel (ANI) qui serait négocié entre les organisations syndicales et patronales. Ce serait en quelque sorte la déclinaison française, sur le volet IA, de l’accord cadre européen de 2020 sur la transformation numérique des entreprises.
Propos recueillis par Mathieu Bahuet et François Tassain
PARCOURS
Économiste de formation, Odile Chagny a contribué à de nombreux travaux de prévision, de prospective et d’analyse des politiques publiques au sein de plusieurs organismes publics (OFCE, France Stratégie, DARES).
Elle rejoint ensuite l’Institut de recherches économiques et sociales (IRES) et oriente ses travaux au service des acteurs syndicaux et des représentants du personnel, menant des projets de recherche sur la transformation numérique et le dialogue social technologique. Elle a coordonné le projet Dial-IA, piloté par 4 organisations syndicales et présenté début 2025, visant à sensibiliser et outiller les acteurs du dialogue social aux enjeux de l’IA au travail.