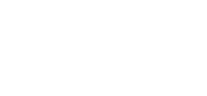Le 22 janvier dernier a été lancée la commission d’enquête sur l’utilisation des aides publiques aux grandes entreprises et à leurs sous-traitants. Objectif : « dresser un état des lieux des aides publiques versées aux entreprises, s’interroger sur leur justification et faire des propositions pour améliorer leur suivi et mieux évaluer leurs effets afin de veiller à l’efficience des deniers publics », selon son président, Olivier Rietman. Ce fut l’occasion pour la CFE-CGC, auditionnée, de partager le constat de la nécessité de travailler sur cette question, la crise sanitaire ayant révélé les nombreuses failles de notre système économique.
AIDES AUX ENTREPRISES EN FRANCE : UN COÛT ÉLEVÉ…
L’aide publique apportée aux entreprises peut être envisagée en quatre volets : les subventions, la garantie financière, la prise de participation, les exonérations fiscales et sociales. Elles sont mises en place par l’État et par les collectivités territoriales et correspondent à différentes étapes de la vie d’une entreprise : création, développement périodes de difficultés. La base de données « aides-entreprises.fr », gérée par les chambres de métiers et de l'artisanat, recense aujourd’hui plus de 2 000 aides publiques financières.
En plus d’être très nombreux, les dispositifs d’aides aux entreprises représentent un coût conséquent. Selon l'Institut de recherches économiques et sociales (IRES), le total des dépenses fiscales, socio-fiscales et budgétaires allouées à ces aides s’élevait à 40,5 milliards d’euros en 2000, soit 2,7 % du PIB. En 2019, ce montant atteignait 156,9 milliards d’euros (6,4 % du PIB). L’aide publique aux entreprises ne cesse de progresser (elle ne représentait que 2,4 % du PIB en 1979) et la crise sanitaire et la guerre en Ukraine n’ont fait qu'accentuer cette augmentation.
D’après l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), l’écart entre le taux de prélèvement obligatoire des ménages et celui des entreprises n’a jamais été aussi élevé. Les entreprises bénéficieraient donc de plus en plus de l’aide publique tout en contribuant de moins en moins au financement collectif. La forte augmentation du montant des aides aux entreprises ne pouvant être entièrement financée par une augmentation des prélèvements sur les ménages, celle-ci a été en partie financée par un accroissement de la dette publique.
… POUR QUELS RÉSULTATS ?
L’objectif des aides publiques aux entreprises est de les encourager à investir davantage et ainsi créer des emplois et stimuler la croissance en s’appuyant notamment sur la théorie dite du ruissellement. Elles s’inscrivent également dans une politique dite de « l’offre » visant à abaisser le coût du travail et à diminuer le taux de chômage.
Au regard du déficit public croissant, du sentiment de déclassement chez les salariés et de la remise en question de la productivité française, il est pertinent de s’interroger sur l’efficacité de ces aides. Mais leurs multiplications et leur constante évolution rendent difficiles leur lisibilité et leur évaluation. En effet, les dispositifs français souffrent d’un manque de transparence et de traçabilité. Ce que rapporte l’Inspection générale des finances (IGF) qui pointait, en mars 2024, « le manque de suivi des aides aux entreprises par l’administration, notamment des aides perçues qui relèvent du régime de minimis et des dépenses fiscales, dont l’IGF a relevé à plusieurs reprises que le suivi et le pilotage n’étaient pas à la hauteur des enjeux budgétaires ».
Aussi, certains dispositifs d’aides aux entreprises peuvent entrainer un potentiel effet d’aubaine. C’est notamment le cas du CIR (crédit d’impôt recherche) et du dispositif d’exonération de cotisation sociale. L’argent public n’aura pas changé la décision de l’entreprise, mais aura amélioré sa rentabilité. Malheureusement, le manque de suivi et d’accès aux informations rendent difficiles la mesure de ce phénomène.
L’exemple de Sanofi illustre parfaitement cette problématique. Pendant plusieurs années, le géant pharmaceutique a bénéficié de centaines de millions d’euros d’aides publiques. Pourtant, en 2024, le groupe décide de supprimer ou d’externaliser près de 3 000 emplois en France en vendant sa branche « santé grand public » et en fermant certains sites. Les aides publiques perçues par Sanofi, dont la vocation principale était d’encourager l’investissement et la préservation de l’emploi en France, ont finalement eu l’effet inverse.
CONDITIONNALITÉ ET SUIVI DES AIDES PUBLIQUES : LES PROPOSITIONS DE LA CFE-CGC
La CFE-CGC propose des solutions permettant d’assurer l’efficacité et le suivi des dispositifs d’aides à destination des grandes entreprises. Ces propositions ont été portées le 3 mars dernier par Nicolas Blanc, secrétaire national à la transition économique, lors de l'audition des organisations syndicales par la Commission d'enquête du Sénat.
Il semble tout d’abord indispensable de soumettre les aides à plusieurs critères :
- En s’appuyant sur le régime existant pour les associations. La CFE-CGC propose d’étendre le dispositif CERFA aux entreprises souhaitant bénéficier des aides publiques. Ce dispositif de demande de subventions, par lequel doit passer toute association, exigerait donc de préciser la nature du projet, son impact économique, environnemental et social, son financement, son périmètre et les parties prenantes. Il exigerait également de justifier la nécessité des aides demandées au regard de la santé financière de l’entreprise et intègrerait des critères d’évaluation du projet.
- En déterminant des critères de conditionnalités répondant à des choix politiques. Il est en effet primordial de définir une vision politique du rôle social des entreprises dans l’impulsion économique, sociale et environnementale afin d’orienter les conditionnalités de ces aides.
- En instituant un processus de révision régulier des critères de conditionnalités en fonction des études d’évaluation.
- En conditionnant l’attribution des aides à la taille de l’entreprise.
Ensuite, afin d’assurer un bon suivi et contrôle des aides, la CFE-CGC propose de :
- Créer une commission de contrôle des aides publiques au secteur privé. L’absence de cadre juridique unifié concernant le contrôle des aides publiques aux entreprises reste problématique. Pourtant, en 2001, la législation instituait une commission nationale des aides publiques aux entreprises dont le secrétariat avait été confié au Commissariat général au Plan pour une courte durée (la loi ayant été abrogée en 2002). Cette commission était chargée d’évaluer les impacts économiques et sociaux et de contrôler l’utilisation des aides publiques accordées aux entreprises.
La CFE-CGC préconise donc la création d’une commission de contrôle de l’utilisation des fonds publics attribués aux entreprises, qui serait chapeautée par le Haut-commissaire au plan et qui pourrait, comme l’ancienne commission, obtenir des organismes gestionnaires d’aides ou des autres autorités compétentes toutes les informations utiles à une parfaite transparence dans l’attribution et l’usage de ces aides.
- Prévoir des sanctions en cas de non-respect. Afin de responsabiliser les entreprises et de s’assurer de la bonne utilisation des aides publiques, il est essentiel de mettre en place des mesures coercitives. La CFE-CGC souhaite que soit inscrite dans le cadre réglementaire ou législatif la possibilité de sanctionner les entreprises. Dans le cas où la commission de contrôle, les membres du comité social et économique (CSE) ou les administrateurs salariés constateraient une utilisation non pertinente des aides, il serait alors possible d’appliquer des pénalités.
Enfin, pour atteindre une politique de conditionnalité efficace, il ne faudra pas négliger le rôle du CSE, qui pourrait occuper une place centrale dans le contrôle de l’utilisation de ces fonds publics, ce afin de garantir que l’entreprise respecte bien les objectifs fixés.
Vinciane Vialard