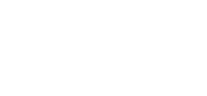Au siège de la CFE-CGC, il a présenté, le 21 octobre dernier, les résultats de l’étude « Disparités salariales et performance des organisations » menée par l’Institut de recherches économiques et sociales (IRES) avec la CFE-CGC. Le colloque (voir le replay vidéo) était animé par Nicolas Blanc, secrétaire national confédéral à la transition économique. L’étude vise à recenser l’ensemble des contributions et études statistiques pour évaluer les effets de la disparité salariale sur la performance. Pas moins de 115 études comprenant 1 200 estimations statistiques ont été récoltées, portant sur 20 pays entre 1990 et 2023. Malgré tout, le besoin de travaux supplémentaires sur l’Hexagone a été très tôt exprimé par Patrice Laroche : « Sur les 115 études pertinentes trouvées, seules deux portaient sur la France. »
UNE QUESTION DE CULTURE
Premier constat : une très forte hétérogénéité dans les résultats obtenus, notamment à cause des différences culturelles. Le fait que les disparités salariales ne sont pas perçues de manière équivalente d’un pays ou d’une profession à l’autre peut parfois être vu comme une excellente chose. Patrice Laroche prend l’exemple de la France et des États-Unis, où l’esprit de compétition et de perception des richesses est très différent. « Aux USA, les forts écarts de salaire et leur progression sont acceptés, voire souhaités. Un PDG qui gagne considérablement plus que ses employés est vu comme un signe de reconnaissance et d’ascension sociale. L’Américain moyen en profitera aussi s’il travaille beaucoup et devient PDG. Quand les salaires des PDG avaient été rendus transparents, les PDG les moins bien payés avaient revendiqué un salaire aussi élevé que les autres ! »
À l’inverse, en France, les fortes différences entre les plus hauts revenus et ceux des salariés sont parfois perçues comme une injustice. « Le haut salaire n’est pas vu comme reflétant les compétences ou le mérite, mais plutôt comme de la chance, le fait d’être bien né, ou la capacité de se rapprocher de la bonne personne au bon moment. » Ces différences culturelles, appelées « effet signal » et « effet tunnel », expliquent en partie l’hétérogénéité des résultats.
Ces derniers coïncident en deux conclusions : la disparité salariale « verticale » (entre postes hiérarchiques différents) a un effet positif sur la performance individuelle. Ainsi, une différence salariale de 10 % entre ces postes s’accompagnerait, en moyenne, d’une augmentation de 0,2 % de la performance (motivation, implication, etc.). En revanche, la disparité salariale « horizontale » (entre individus occupant le même poste) produit un effet négatif équivalent, générant un sentiment d’injustice et de démoralisation.
TROUVER UN ÉQUILIBRE
Les écarts de rémunération associés au passage d’un niveau hiérarchique à l’autre dans les organisations seraient donc positifs, incitant les individus à faire des efforts pour obtenir la promotion convoitée (théorie du « tournoi », fondée en 1981 par les économistes américains Sherwin Rosen et Edward P. Lazear). Attention toutefois, prévient Patrice Laroche : « Au-delà d’un certain seuil, elles deviennent démotivantes pour les salariés. Il faut donc trouver un équilibre pour maximiser les effets positifs des écarts salariaux, tout en limitant leurs impacts négatifs sur la cohésion et la performance globale. »
Leur acceptation dépend de nombreux facteurs, notamment la confiance entre individus dans une même société. « Un salarié qui a confiance dans les manageurs ou la direction tolérera plus facilement les écarts salariaux, qu’ils soient horizontaux ou verticaux », explique Patrice Laroche. L’autre élément d’acceptation est la justification de ces différences de salaires : « Les écarts de rémunération doivent être mesurés et justifiés à l’aide d’indicateurs objectifs vis-à-vis de l'expérience, de la productivité et des performances de l’individu. »
François Hommeril, président de la CFE-CGC, est intervenu sur ce sujet : « Mon plus ancien souvenir de militant syndical, c’est une réunion avec la direction générale lors d’une négociation salariale tendue. Un collègue syndicaliste avait menacé de mener une enquête salariale interne et la DG avait instantanément plié et accepté de négocier. J’ai découvert que ce qui fait le résultat d’une négociation, c’est la pugnacité syndicale et aussi l’objectivation des données, y compris salariales. Montrer les écarts, les expliquer et les mesurer est un levier syndical essentiel. Cela permet d’élever le débat et de gagner les argumentaires grâce à une vision globale. »
QUEL RÔLE POUR LES SYNDICATS ?
Pour Patrice Laroche, les syndicats ont une contribution majeure à apporter dans la lutte contre les disparités salariales injustifiées : « Ils peuvent intervenir en amont, en négociant des critères de rémunération adaptés à chaque entreprise, afin d’encadrer et de limiter les disparités. »
En veillant à ce que les processus de rémunération soient clairs et justes, les militants syndicaux peuvent améliorer le quotidien des salariés et les aider à mieux comprendre certains écarts de salaires, dès lors qu’ils sont légitimes. « Il est plus facile de faire accepter une décision à quelqu’un qui a été consulté, informé, d’où l’importance des CSE dans le processus de décision de l’entreprise vis-à-vis des rémunérations », note Patrice Laroche. Les retombées ? Une restauration de la confiance au sein de l’entreprise, une amélioration de sa performance et de la satisfaction des salariés.
« Les syndicats ont aussi une mission importante en défendant l’accès à la formation et à l’évolution de carrière pour tous. Cela permet de donner des perspectives de progression aux salariés, notamment les moins bien rémunérés, et de réduire le sentiment d’injustice », souligne Patrice Laroche.
TRANSPARENCE SALARIALE : JUSQU’OÙ ALLER ?
Lors des questions-réponses, la transparence salariale, pour laquelle la CFE-CGC est mobilisée, a beaucoup été abordée. Le sujet est d'actualité : cette transparence salariale s'inscrit dans le cadre de la directive européenne de mai 2023 qui devra être transposée dans le droit français d'ici juin 2026.
Pour Patrice Laroche, « la transparence est une très bonne chose car elle réduira les écarts injustifiés en donnant plus d’informations aux salariés. Mais une transparence totale (révélation des salaires individuels) serait risquée, pouvant entraîner des jugements entre collègues. C’est pourquoi la loi européenne propose de fournir des agrégats de salaire, mais pas les salaires exacts ». Autre point important : s’assurer que l’attribution des primes soit aussi transparente, sans quoi le système serait dysfonctionnel.
S’agissant de l’utilisation de l’IA à des fins de surveillance, notamment via des indicateurs de productivité et de performance très subjectifs (nombre de mails envoyés, interactions quotidiennes…), « il faudra que les syndicats soient attentifs à ces surinterprétations de la performance », juge Patrice Laroche.
Le chercheur a également indiqué que, malgré les résultats de l’étude, il reste encore des zones d’ombre, notamment sur le secteur public, encore très peu étudié et absent de l’étude IRES.
En conclusion, Patrice Laroche a rappelé que « la régulation des disparités salariales ne se décrète pas mais qu’elle se construit par la négociation, la transparence et l’équité. »
François Tassain